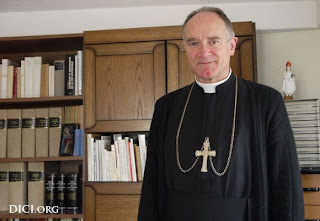Souhaitons que cette nouvelle révélation fasse réaliser aux prêtres jusqu'où peut aller leur supérieur...
source icres
La nouvelle a été révélée par l’abbé Girouard, dans son sermon du 2 juin 2013.
Ce prêtre
canadien, résistant au vent de ralliement qui balaie la FSSPX, a rendu
compte d’un fait important expliquant la nouvelle attitude de Menzingen
vis-à-vis de la Rome conciliaire. De quoi s’agit-il ?
En octobre 2012, notre abbé se plaint à
son Supérieur, l’abbé Wegner, de voir la Fraternité amoindrir, voire
abandonner la lutte contre Vatican II et contre les erreurs qui en sont
issues. Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsque le Supérieur lui
répondit en substance: C’est exact, mais c’est une bonne chose ! J’en
suis d’ailleurs un peu responsable. L’Abbé Wegner explique alors : «
quand j’étais Supérieur de District en Hollande j’ai rencontré et suis
devenu l’ami du Président d’une société de conseil…Par la suite j’ai
demandé à cet ami de faire le « marquage », le « branding » de la
Fraternité, car la société de cet ami est en effet spécialisée dans le
branding. »
Un mot d’explication sur ce vocabulaire
barbare. A quoi sert le branding ? Ce terme, emprunté à l’élevage,
désigne d’abord l’action de marquer au fer rouge les animaux, afin de
faire connaître leur propriétaire. Appliqué à une entreprise, le
branding est censé aider à se positionner sur le marché, à mieux faire
valoir sa spécificité et à se démarquer de ses concurrents. Cette
opération, censée faire le management de la marque, consiste à évaluer
le delta entre une institution telle qu’elle souhaite paraître devant le
public et la manière dont elle est perçue. Cela suppose une enquête
d’opinion auprès des clients et des non-clients, portant sur les points
forts et sur les points faibles, afin d’évaluer l’image de marque. Puis
l’on décide des changements à apporter dans l’institution pour mieux
faire coïncider son image avec ce que l’on souhaite.
les-gens-disent.jpg L’Abbé Wegner joue
ensuite les intermédiaires auprès de Mgr Fellay qui donne son accord
pour la mission de conseil. Censé répéter tel un perroquet les dires de
l’opinion, l’homme d’affaires rédige son rapport sur la FSSPX. Selon
lui, la Fraternité fait fausse route depuis le début … Son image de
marque est tellement négative que jamais le public ne sera attiré. Elle
est vouée à la stagnation, voire au déclin. L’argument dirimant de la
société-conseil, selon l’Abbé Girouard, est peu ou prou le suivant : «
L’Église de Vatican II est comme un vieil homme mourant, elle est comme
un mourant étendu dans la rue, comme ça: Ils perdent leurs séminaires,
ils perdent leurs monastères, ils vendent leurs églises ; c’est une
Église moribonde. Et vous avez vraiment une mauvaise image lorsque vous
continuez à combattre cette Église. Vos critiques vous font paraître
cruels, comme si vous exagériez. C’est comme nouvelle image de marque
doit changer complètement. Vous devez arrêter de discuter à coup
d’arguments ; vous devez cesser le combat. Vous devez plutôt vous
concentrer sur le côté positif, et montrer la beauté de la liturgie
traditionnelle, la beauté de la théologie traditionnelle, et de cette
façon, on ne vous percevra plus comme des gens cruels, amers ou comme
des êtres de ce genre. »[2]
Ce domaine du conseil, on l’aura
remarqué, évolue, par construction, au niveau de l’opinion, du ressenti,
du vécu des uns et des autres. La subjectivité tient lieu de réalité
indépassable. La Fraternité a voulu se regarder dans le miroir de
l’opinion. Pour quelles raisons ? Par inquiétude ? Par souci pastoral ?
Pour mieux convertir les âmes ? Ne sait-on pas que c’est la Grâce qui
convertit, que la sainteté attire la Grâce et non toutes ces histoires
d’image de marque ? Saint Paul, saint Dominique ou saint François Xavier
se souciaient-ils de leur image de marque ? L’esprit mondain se
manifeste souvent en ceci que l’on supporte mal d’être snobé par le
monde. Hélas ! Mgr Fellay a prêté l’oreille aux sirènes de la renommée.
S’est-il interrogé sur la pertinence des méthodes d’une société de
conseil chargée d’évaluer la valeur d’une marque sur le marché, avant de
les appliquer à la société de prêtres dont il est responsable? Quoi
qu’il en soit, Menzingen se voit embarqué sur les chemins de la
subjectivité où la perception de l’autre est plus importante que ce que
l’on est, où l’opinion du public joue un rôle plus déterminant que ce
que l’on fait. La messe de toujours, les sacrements, dont la Grâce
découle du Sacrifice de la Croix, la lutte contre le modernisme sont
réévalués à l’aune du qu’en dira-t-on.
Ce qu’on appelle le « value based management » ou «Management par les valeurs»
Mgr Fellay veut depuis fort longtemps un
rapprochement avec Rome. Ce qu’il souhaite va donc dans le même sens
que les conclusions de la société de conseil : faire taire les critiques
et se concentrer sur le positif : la liturgie, la doctrine. Le
consulting n’a donc pas été l’élément déclencheur, mais a servi de
confirmation. La « science managériale » n’a fait que corroborer les
analyses du prélat : un changement de cap est nécessaire. Mais ce
changement de cap représente plus qu’un simple réajustement. Il comporte
un véritable désarmement spirituel, une abdication, une attitude
d’acceptation ou d’indifférence envers ce que la Fraternité a combattu
depuis plus de quarante ans … Restons sur le plan du diagnostic
d’entreprise, choisi par Mgr Fellay. Qu’en disent les managers ? Sur le
plan de la psychologie de groupe, ils proposent une analyse propre à
fabriquer un modèle manipulateur où l’on distingue la culture de
l’éthique Yvon Pesqueux et Yvan Biefenot analysent la culture
d’entreprise et l’éthique d’entreprise. Rien de plus légitime en
apparence. Selon nos deux auteurs, la culture et l’éthique font certes
référence à un modèle de croyances et de valeurs, mais l’un ne peut se
confondre avec l’autre. La culture relève des données sociologiques par
lesquelles chacun s’identifie. Elle suppose une stabilité, une tradition
constituant le ciment social. Le fonds commun des relations entre les
parties prenantes de cette même culture permet reconnaissance mutuelle
et solidarité. En période de crise, quelques valeurs enfouies refont
surface et assurent une meilleure unité des consciences et des mœurs. La
culture donne à l’entreprise sa spécificité, sa forme, son essence.
En quoi consiste la manipulation ? En
ceci : « l’éthique » se situe davantage dans la préoccupation de la vie
quotidienne et de la survie. Elle concerne la stratégie et la tactique.
L’éthique couvre le champ pratique de l’action. L’éthique peut entrer en
conflit avec la culture. Comment se présente une telle éventualité ? La
déchirure vient de l’extérieur, de l’adversité, du monde qui bouge et
qui pose à l’institution la question de sa survie. Le monde des affaires
pense que, pour avoir une culture, encore faut-il exister. Etant
persuadée que l’existence précède l’essence, l’entreprise préfère «
l’éthique » tournée vers l’avenir, à la « culture » accusée de rigidité
et d’inadaptation. Il ne faut pas chercher ailleurs la raison des
restructurations permanentes, de la disparition des métiers, de la
mentalité évolutionniste amoureuse par principe de tout ce qui est
nouveau. Opposer la culture d’une institution à l’éthique de son action,
c’est réputer la culture actuellement dénuée de fondement rationnel. On
la prive arbitrairement de justifications autres que sentimentales,
tout en accordant les vertus salvifiques à l’éthique, toute entière
tournée vers la vie et vers l’excellence … Voilà pour la manipulation.
Néanmoins, les consultants d’entreprises le savent : imposer la
prépondérance de la présumée « éthique » sur la culture n’est pas une
opération se déroulant comme sur un long fleuve tranquille. La nature
réagit. C’est à la culture que sont attachés la plupart des salariés.
Pour quelles raisons ? Parce que cette culture représente la loi et que
cette loi est connue. Il n’en va pas de même pour l’éthique, entrée en
conflit avec la culture pour cause de passéisme. L’ensemble du personnel
voit ce changement d’un mauvais œil. Non pas seulement, comme on
l’entend souvent dire, par attachement paresseux aux habitudes, ou
encore par la peur irraisonnée de l’inconnu. Ce qui suscite les craintes
et les oppositions du personnel, c’est le désordre moral qu’engendre le
changement des fondamentaux : la non reconnaissance des vertus
acquises, la remise en cause du mérite, l’oubli des services rendus,
l’abandon obligé des valeurs jusqu’ici en vigueur. C’est la création
d’une situation d’injustice. Dès lors, l’entreprise court le risque de
passer pour cynique. D’où le recours au terme d’éthique. Le vocabulaire
est important, car il conjure l’accusation d’immoralisme. C’est pourquoi
une nouvelle hiérarchie de « valeurs » devra accompagner le changement.
C’est ce qu’on appelle le « management par les valeurs ».
Conséquences relationnelles et morales
Le changement de culture reste, pour une
entreprise, une opération à haut risque. Les spécialistes s’accordent
sur ce point. Ecoutons ce qu’en disent les professeurs de HEC de
Montréal : « Le changement culturel peut engendrer des comportements
agressifs et opposés à l’idée même du changement. Beaucoup de pays et
d’organisations en ont fait la douloureuse expérience. Ainsi, une des
raisons les plus probables de la grande débâcle qui a emporté la société
Béatrice est précisément la remise en cause de la culture
quasi-spartiate qui y régnait jusqu’à la fin des années 70 (Hafsi, 1980)
De même les difficultés et les soubresauts connus par beaucoup de pays
en développement peuvent être reliés à la brutalité des changements
culturels qui s’y sont produits. (Kiggundu, Jorgensen & Hafsi, 1983)
» Pour faire face à la grogne, la direction procède alors à quelques
mutations, favorise la promotion-récompense des dociles, met les autres
au placard, voire licencie les fortes têtes « psychorigides » dont on
doit – bien à contrecœur, croyez-le ! – se séparer. Une mentalité de
circonstance, assez neutre, fait son apparition. Elle tient lieu de
sagesse. À l’exclusion, la majorité préfère l’institution, quelle
qu’elle soit. Le plus grand nombre ne défend ni la culture ni l’éthique,
mais une convention assez molle, sans odeur ni saveur. C’est plus
malin. On ne plaint pas les opposants sanctionnés : ils ont récolté que
ce qu’ils méritaient. On va jusqu’à leur en vouloir d’avoir critiqué le
patron, d’avoir mis en danger la solidité de l’entreprise. L’existence
de l’institution passe avant sa finalité. L’existence précède l’essence.
Il en résulte une chute vertigineuse de la moralité. Le manque de
solidarité des membres de l’entreprise pose rapidement un problème. La
concurrence interne des salariés remplace le désir de bien faire ; elle
n’apporte d’ordinaire aucune plus-value, mais au contraire rétention
d’information et divers blocages. L’investissement personnel de chacun
s’en ressent.
Le monde de la religion et le monde des affaires.
Ce qui présente un risque important pour
l’entreprise n’a vraiment aucun sens pour une institution religieuse
catholique dont le fondement est la Foi catholique. Pour diverses
raisons, dont la principale est que le surnaturel n’est pas fondé sur
les mêmes principes que le monde naturel. Développons ce constat plus en
détails. Les conclusions du cabinet-conseil néerlandais concernent le
comportement des non-clients de la FSSPX, car ceux qui suivent cette
institution ne sont pas révulsés par les critiques adressées à la Rome
conciliaire. Lorsqu’on cherche à gagner des parts de marché, autrement
dit, lorsqu’on veut se tourner vers les non-clients, Peter Drucker dans
Managing for résults, livre culte toujours d’actualité, pose d’abord le
dogme que le client n’achète pas un produit, mais une satisfaction
(toujours ce subjectivisme !). L’auteur incite ensuite à se poser
plusieurs questions dont les plus importantes sont les suivantes : Qui
est le non-client, alors qu’il fait potentiellement partie de la cible ?
Pour quelles raisons ne franchit-il pas le pas ? Et subséquemment : «
Quoi modifier pour arriver à produire les satisfactions qu’attend le
client ? » Ces questions, et la pensée profane allant avec, ont infesté
Menzingen. On sait que les « non-clients » de la FSSPX ont peur du
schisme. Ils aiment la liturgie traditionnelle, mais ils estiment la
Fraternité, sinon hors de l’Eglise, du moins en désobéissance aux
autorités légitimes. Ce qu’ils veulent, c’est le certificat de
conformité, dûment délivré par les autorités compétentes. Selon eux,
l’autorité visible a raison. La théologie s’arrête là. Ils ne
s’interrogent plus sur la Foi de l’Eglise : le Pape suffit à faire le
vrai, quoiqu’il dise, quoiqu’il fasse. Faut-il donner un exemple ?
Jusque sous Pie XII, l’Eglise s’efforçait de mettre en garde contre les
fausses religions. Aujourd’hui, les rassemblements d’Assise, impensables
encore sous le Pasteur angélique, passent pour de beaux gestes de
Charité. Le grand nombre accepte sans broncher: la structure a toujours
raison. Peuples, battez des mains ! Or, pour des raisons de Foi, on ne
peut pas marier la liberté religieuse avec le credo catholique, ni
mettre la liberté humaine au-dessus de la Révélation, ni admettre
plusieurs « vérités » dissemblables, etc. En un mot, il est impossible
d’accepter le magistère de la Rome actuelle. On ne peut donc pas
satisfaire les attentes des « non-clients » sans devenir comme eux,
c’est-à-dire sans devenir des positivistes, suivant inconditionnellement
la structure visible « Eglise » sans se demander si elle reste fidèle à
sa finalité.
Conclusion
Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, le malaise de la Fraternité est patent. Mgr Williamson a été
exclu, les opposants sont diabolisés. L’atout majeur de Mgr Fellay est
de pouvoir de muter l’un, de sanctionner l’autre, d’interdire la
publication de tel article ou de favoriser la promotion de tel prêtre
particulièrement docile. De la motivation fondée sur la Foi et le zèle
ardent pour la défense de la Foi, on passe graduellement à la motivation
fondée sur la peur. Tout commençait par la recherche du Règne de
Notre-Seigneur Jésus-Christ ; tout continue maintenant par l’application
du Branding et la flagornerie qu’il entraîne. Beaucoup de prêtres se
taisent et attendent de voir ce qui va se passer. D’autres font
remarquer leur orthodoxie par les critiques qu’ils adressent à leurs
anciens collègues (tels l’abbé Laisney se chargeant de « réfuter »
l’abbé Chazal, ou l’abbé Bouchacourt, conspuant Mgr Williamson pour
avoir osé venir au Brésil donner des confirmations dans une congrégation
ne faisant pas même partie de la FSSPX.). Prions pour tous ces prêtres.
Nous convenons volontiers que cet article ne répond pas exhaustivement
aux questions que soulève le recours au Branding pour définir la
stratégie de la FSSPX. M. L’abbé Girouard a tout de suite vu le côté
dérisoire et navrant de cette démarche. « Et dire que c’est nous qu’on
accuse de manquer d’esprit surnaturel ! » dit-il avec étonnement.
Certes, pour orienter la Fraternité, n’aurait-il pas été plus judicieux
d’avoir recours à la pensée du fondateur, Mgr Lefebvre ? « Aucune
compromission avec le modernisme ! Tout pour le Christ Roi ». Mgr Fellay
s’apercevra sans doute un jour qu’il a ruiné l’œuvre de Mgr Lefebvre en
préférant les sirènes de l’éthique des affaires à l’élan surnaturel du
missionnaire poussé par l’amour du Christ-Roi, en accordant trop
d’importance au souci mondain du « paraître » ou du « qu’en dira-t-on »
et en oubliant « la folie de la Croix ». Il se souviendra peut-être de
l’avertissement du Christ (Mt. 10, 22) « Vous serez haïs de tous à cause
de mon Nom. » Quant à nous, préférons cette béatitude, car c’en est
une, au management de ma marque de fabrique.
Hugo Clémenti
Nous ne saurions trop recommander au lecteur de se reporter au texte de ce sermon, paru sur le site de l’Abbé Girouard : http://www.sacrificium.org/fr
On aura le texte exact de l’Abbé Girouard sur son site. Nous avons modifié le « style parlé ».
Yvon Pesqueux et Yvan Biefenot,
L’éthique des affaires, management par les valeurs et responsabilité
sociale, Edition d’organisation, 2002.